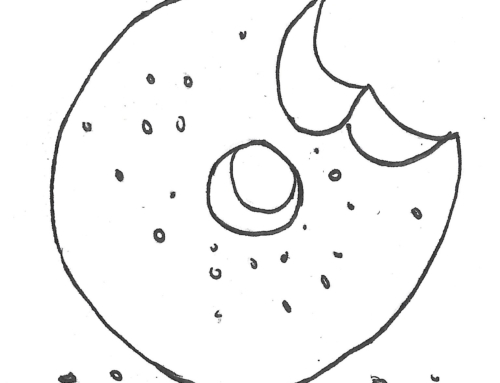Un jour, Geneviève se présente au Griendel avec Marie-Ève, qui me prend dans ses bras. Sa peau sent la terre. Ses joues sont fraiches, trop. Ses mouvements évoluent dans des trajets au ralenti, comme s’ils laissaient des traces de leur passage dans l’air. Elle parle, rit, change de position sur sa chaise, veut simuler, coûte que coûte, une forme de bien-être.
Marie-Ève apparaît à notre terrasse une fois par mois. À chaque fois, je mémorise sa manière de croiser les jambes, de tourner les mains autour de ses poignets, sa bouche qui s’ouvre, hilare, sa tête qui bascule vers l’arrière et le lent parcours de ses doigts qui s’infiltrent parmi ses cheveux.
Lorsque je me promène dans un supermarché ou dans une pharmacie, je m’arrête devant des reflets et je mime Marie-Ève, m’entraînant à une chorégraphie mémorielle. Je le fais pour Geneviève. Puis, je répète ma danse devant elle, assise à notre terrasse avec sa pinte à la main. Je n’ai pas honte de ma ridicule tentative, de ma mécanique affective. Ma poésie corporelle saisit ce qu’il reste de nos rendez-vous à la terrasse avec Marie-Ève.
[La suite, bientôt… à la trace 12 de résidence !]