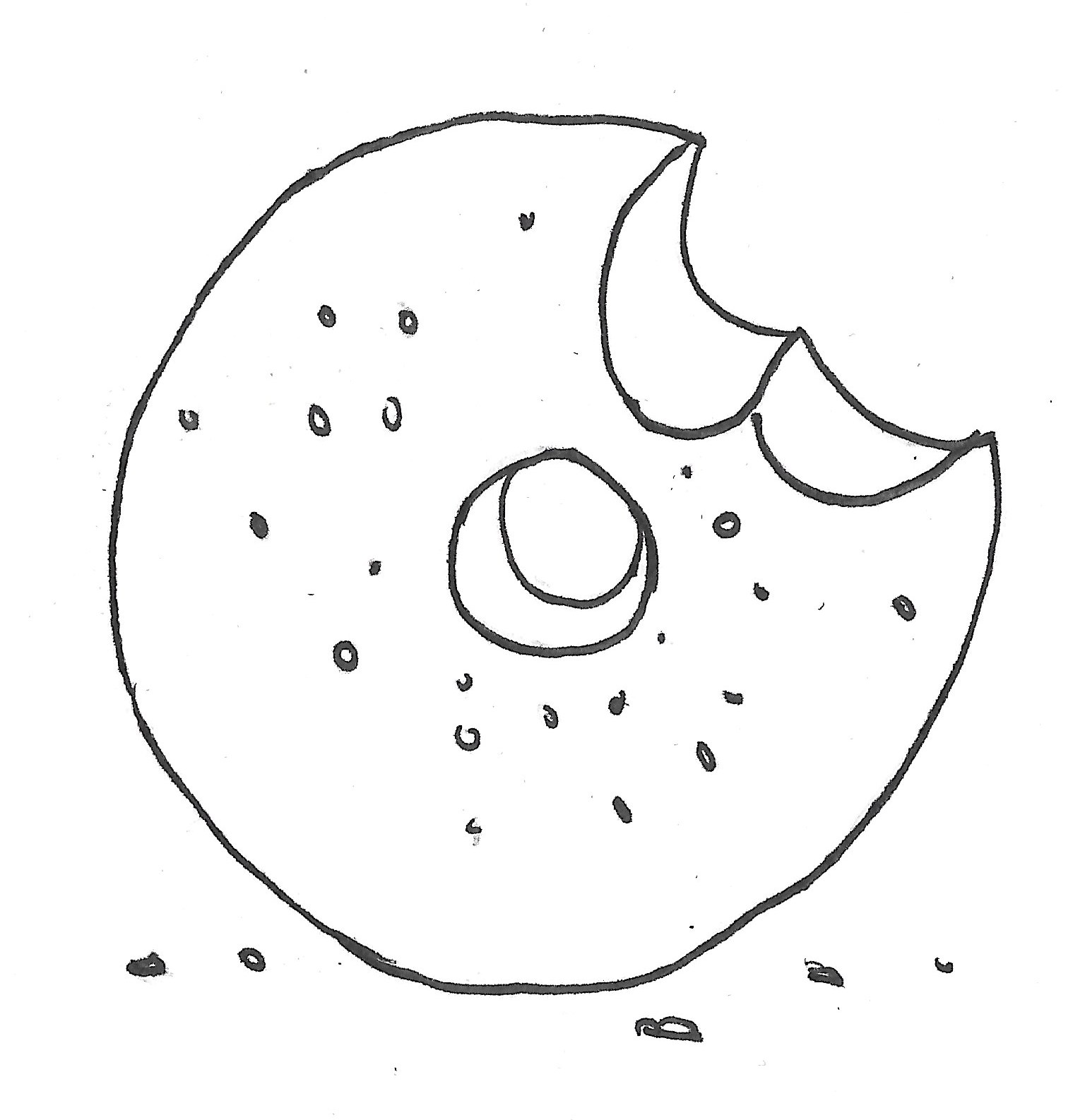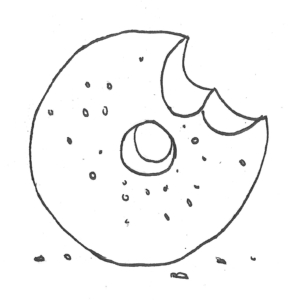Dix ans, la dernière fois que nous sommes allés chercher des bagels sur St-Viateur, un lundi soir. Je me souviens en avoir mangé un, au pavot. Pas au complet, mais quand même. Mon père et ma mère n’ont pas souligné l’exploit, conscients de sa fragilité.
Avant, je trouvais que douze bagels, c’était beaucoup, comme je m’imaginais qu’une décennie, c’était long. Il n’en est rien.
Malgré que tout a changé, que G. est entré dans ma vie, que mon poids a augmenté et que la taille de mes repas n’a plus rien d’alarmant, certaines choses restent. Les arrière-pensées continuent de se rejouer, comme une vieille mélodie en sourdine de chaque instant.
L’été dernier, ma grand-mère était en visite chez mes parents. Elle buvait un scotch dans la cour quand je suis arrivée. Le regard plein d’admiration, elle a mis une main sur ma cuisse pour la tapoter, a flatté la courbe de mon mollet avec sa paume. M’a dit que ça m’allait bien.
J’ai eu envie de vomir. De refuser mes brochettes de tofu . De retourner chez nous jeûner jusqu’au lendemain pour effacer les chairs dont elle venait de souligner le rebondi. J’ai eu chaud de colère, de révulsion. Mais je suis restée, ai mangé normalement en réprimant mon irritation.
Ma grand-mère n’a rien remarqué. Elle ne cessait de me jeter des regards souriants auxquels je répondais par automatisme, sans joie. Je lui en voulais.
À la fin de la soirée, en me serrant dans ses bras, elle m’a dit qu’elle était fière de celle que j’étais devenue. Que j’étais sur la bonne voie.
Je ne l’ai plus revue.
En décembre, j’ai embrassé son cadavre amaigri dans une chambre d’hôpital. Au contact de sa joue osseuse, je me suis rappelé sa dernière étreinte, ses paroles à mon endroit. J’ai décidé d’en faire ma prophétie.