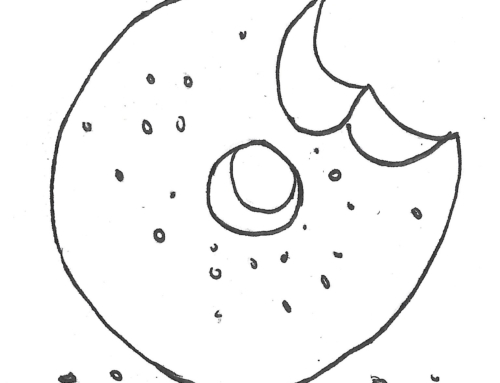Hiver. Basse-ville de Québec.
Les jours ont commencé à allonger. C’est début février, l’hiver est loin d’être fini, il fait vingt degrés sous zéro et la neige crisse encore sous les bottes, mais la lumière a changé. Le soleil semble plus vif, et il fait encore clair à 16h30. En fin de journée, le ciel se teinte de rose. Quand il fait très froid, de la vapeur s’élève au-dessus des glaces sur le fleuve. Avec Fred, qui veut toujours marcher, peu importe le temps qu’il fait, on monte parfois sur les plaines d’Abraham, pour voir le fleuve d’en haut. Je le laisse choisir le chemin du retour, au gré des pistes d’odeurs qu’il suit comme on chercherait un trésor.
Ces jours-ci, je fais des rêves de printemps, de glaces qui fondent sur le fleuve et de légumes qui poussent dans leur pot, sur mon balcon. Je me demande si mon grand-père fera son jardin cette année. Mes grands-parents vivent dans le quartier Limoilou, dans leur maison, malgré leurs presque cent ans, leurs sens, leur corps et leur mémoire qui déclinent. Aux yeux des autres, c’est dangereux, inquiétant. Il va finir par leur arriver un accident. À leurs yeux c’est impensable de vivre ailleurs, de modifier leur mode de vie, d’accepter de l’aide. Ils protègent jalousement leur intimité et leur liberté, quitte à mentir. Mon grand-père fait parfois semblant d’avoir entendu, plutôt que de demander aux gens de répéter. Ma grand-mère cache ses pertes de mémoire. Les bons jours, elle convainc l’infirmière du CIUSSS que rien n’a changé. Elle prend des notes sur son calendrier, écrit les évènements importants, les rendez-vous. Son écriture manuscrite est élégante et régulière. Si on regarde de près, cependant, on s’aperçoit que les notes sont là, mais dans le désordre – le mauvais, jour, le mauvais mois.
Pour faire taire les gens, mon grand-père dit chaque hiver qu’il mettra la maison en vente au printemps. Mais chaque année, dès que la terre dégèle, plutôt que de planter une pancarte devant la maison, il commence son jardin. Je soupçonne que c’est plutôt un voisin qui prépare la terre, ensemence et arrache les mauvaises herbes, maintenant, pendant que mon grand-père lui donne ses instructions. Mais c’est toujours un grand jardin, fourni, luxuriant, généreux, qui nourrit la fierté de mes grands-parents. Rhubarbe, tomates, concombres, haricots, fines herbes, courges. Il y a encore quelques années, ma grand-mère mettait les tomates et les haricots en conserve, faisait des herbes salées, des cornichons et des tartes à la citrouille. Elle fait encore de la confiture de rhubarbe, sa préférée, dont elle aligne les pots dans le congélateur, encore et encore. Il y en a pour tout un village.
L’autre jour mon grand-père m’a montré ses mains. Il voulait me montrer qu’elles sont ridées. Il m’a dit que c’est nouveau, qu’elles n’étaient pas comme ça avant. J’ai pensé que la vieillesse n’arrive pas d’un coup, du jour au lendemain, mais que peut-être il venait juste de s’en apercevoir, lui. Je n’ai rien dit. Il regardait ses paumes encore larges et ses gros doigts d’ancien mécanicien, touchait la peau devenue fragile, parcheminée. J’ai pensé que toute sa vie était inscrite là. J’ai placé mes mains ouvertes près des siennes, sur la table de la cuisine. Une minute s’est écoulée en silence.