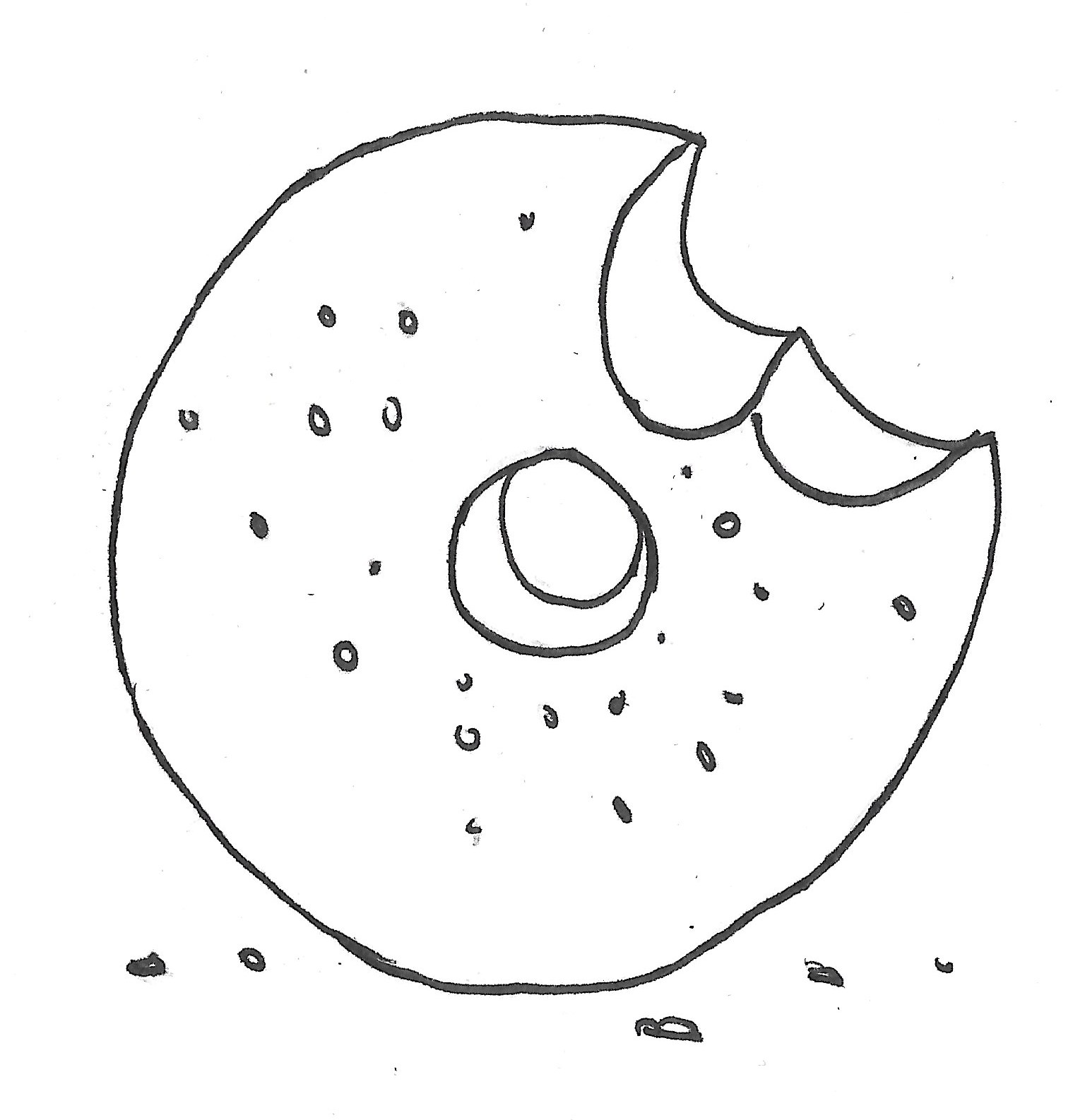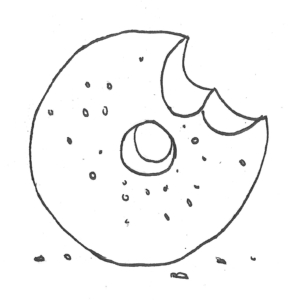Lundi de fin août. Je commence l’université dans une semaine. Je ne sais pas si je suis prête à prendre le métro jusqu’à Côte-des-Neiges, à risquer les lunchs de la cafétéria et à endurer les cours qui finissent à 19h.
Une semaine comme un ultimatum. Une semaine pour me fabriquer une confiance de dernière minute.
Les soirées se hâtent davantage, il fait déjà presque nuit. La Van roule sur l’Avenue du Parc. Ma mère est assise en copilote. Pour la dernière rencontre avec ma psy, mes deux parents sont présents. L’heure du bilan, avait dit mon père.
Ma psy tire une deuxième chaise du bureau voisin pour que ma mère puisse prendre place. D’entrée de jeu, elle demande à mes parents ce qu’ils pensent de mon parcours des derniers mois. Ils me félicitent comme une maternelle après son premier jour d’école. Gênant et infantile sont les mots qui me viennent en tête. Quant à elle, ma thérapeute se dit enthousiasmée par mes progrès rapides, par ma volonté de m’en sortir. Mon poids est maintenant sain, mon mental aussi. En théorie.
Je me tourne vers mes parents, qui rayonnent. Dans leurs yeux luisent des larmes. C’est à ces larmes que je mesure la peur qui les a habité, qui les tenaille peut-être encore. En sortant, je force un sourire en remerciant ma psy. Je ne suis pas prête à affronter le reste, mais il le faudra.
En redescendant vers le pont, mon père tourne sur St-Viateur. Ma mère demande ce qui se passe, ce n’est définitivement pas un raccourci. Mon père et moi nous jetons un regard complice. Je sens déjà la chair moelleuse, chaude, les pavots craquant sous la dent.
Mais à mesure que l’enseigne approche, l’angoisse réapparaît, encore, incendiant mes tempes. Je voudrais qu’on fasse demi-tour.
Quand est-ce qu’on sait que c’est fini?