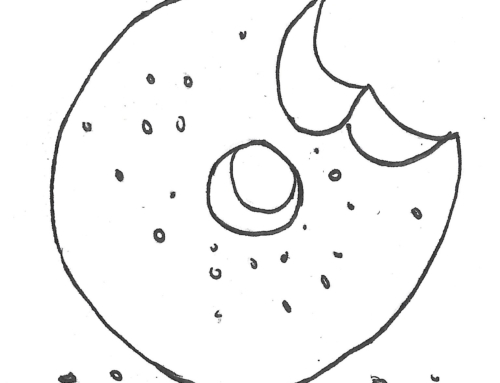2. Un peu plus d’explications sur l’idée d’instauration et d’incantation; de la « bifurcation » de Whitehead; du potentiel philosophique de la recherche-création
Retour sur l’art comme expérience
Puisqu’il se terminait par les mots « à suivre », j’ai voulu vérifier où s’arrêtait mon premier texte. Avec le recul, j’ai l’impression d’y avoir condensé toute une série d’idées peut-être pas si évidentes que ça, somme toute. Je vais donc développer encore un peu plus loin cette idée d’instauration, puis j’en arriverai au lien à faire avec la recherche-création.
En substance, j’ai proposé la dernière fois que l’art opère en mettant en place les paramètres d’une expérience à vivre. Nul besoin de préciser qu’il s’agit d’une « expérience esthétique », car c’est la nature même d’une expérience que d’être « esthétique », selon Dewey, au sens où, à la différence d’une simple série d’événements séparés, une expérience est composée d’événements qui forment un tout entre eux. Même lorsqu’elle est vécue comme chaotique, l’expérience a une intégrité qui la définit comme expérience. Elle est un tout. Et toujours selon Dewey, dans ce livre au titre éloquent L’art comme expérience, l’œuvre d’art – dans sa manière d’être contenue, intégrée et formellement irréductible –, est un peu comme un paradigme de l’expérience. Voyons ce propos de Brian Eno :
Cessons de penser aux œuvres d’art comme à des objets, mais comme à des déclencheurs d’expériences. (La phrase de Roy Ascott.) Cela résout plusieurs problèmes : on n’a plus besoin d’argumenter si les photographies sont de l’art, ou les performances, ou les briques de Carl André ou la pisse d’Andrew Serranos ou « Long Tall Sally » de Little Richard, parce qu’on dit : « L’art est quelque chose qui se produit, un processus et non une qualité, et toutes sortes de choses peuvent le faire se produire ». […] Ce qui rend une œuvre d’art « bonne » à vos yeux n’est pas quelque chose qu’elle contient, mais quelque chose qui arrive en vous – et la valeur de l’œuvre réside dans la mesure où elle peut vous aider à vivre le genre d’expérience que vous considérez comme artistique. (Cité par Maria Popova – je traduis ((« Stop thinking about art works as objects, and start thinking about them as triggers for experiences. (Roy Ascott’s phrase.) That solves a lot of problems: we don’t have to argue whether photographs are art, or whether performances are art, or whether Carl Andre’s bricks or Andrew Serranos’s piss or Little Richard’s “Long Tall Sally” are art, because we say, “Art is something that happens, a process, not a quality, and all sorts of things can make it happen.” … [W]hat makes a work of art “good” for you is not something that is already “inside” it, but something that happens inside you — so the value of the work lies in the degree to which it can help you have the kind of experience that you call art. »)))
C’est drôle… la semaine dernière, un évaluateur externe d’un article que j’avais proposé quelque part a critiqué cette notion même d’expérience en lien avec l’art – comme si le fait d’associer l’artistique au « vécu » et à l’expérience dénotait une sorte d’anti-intellectualisme ou une vision non éduquée de l’art, opposant pensée à expérience vécue. On a même voulu me rappeler que « l’art contemporain a précisément été le domaine de la pensée par excellence »! Étrange critique. Car même les œuvres à teneur très conceptuelle ou portant des contenus intellectuels élaborés actualisent ces contenus dans une expérience (donc sensible et d’ordre esthétique). Dire que l’œuvre d’art est de nature expérientielle n’invalide en rien sa puissance intellectuelle.
Loin d’opposer « expérience » à « pensée », je tente précisément de comprendre comment l’art provoque et soutient la pensée. La dernière fois, je reprenais une distinction de Merleau-Ponty (1945 : chap. vi) entre un acte d’expression qui véhicule une idée déjà faite et un acte d’expression qui fait arriver le sens dans le lieu même. Dans le premier cas, on a des symboles qui servent de véhicules à des idées ou des concepts et dans l’autre, on a des formes et des matières qui créent les conditions dans lesquelles une signifiance sera réalisée et vécue – j’ai qualifié ce deuxième mode d’« incantatoire » ou « instauratif ». Mon évaluateur anonyme faisait remarquer que « toute réflexion sur ces questions ne peut faire l’économie d’une réflexion sur les origines, la persistance et le dépassement nécessaire des dualismes traditionnels (théorie/pratique; expérience/pensée; intuition/réflexion…) », ce avec quoi je ne peux qu’être d’accord – avec bien sûr une certaine frustration due au fait qu’il (elle?) a lui-même (elle-même?) brandi cette opposition.
La bifurcation
Ce problème de dualisme me semble lié à l’éthos d’une société avancée et lettrée. La pensée conçue comme un ensemble de contenus abstraits, s’élaborant indépendamment des dynamiques chaotiques ayant cours dans le monde physique (et l’expérience qu’on en fait), cela ne peut exister qu’en mode d’écriture. Dans The Concept of Nature, Alfred North Whitehead a appelé « bifurcation » le moment où cela s’est produit – et qui est un moment dans l’évolution de la science, lorsque les choses que nous percevons (disons les couleurs ou la matière) se sont avérées de composition différente (longueurs d’onde ou électrons et protons) en laboratoire. En d’autres termes, il y a à ce moment « “bifurcation de la nature en deux systèmes de réalité”, l’un qui serait composé d’entités physiques, étudiées par la science, et l’autre qui relèverait de la vie de l’esprit » (Taleb, 2011). Cela se passe entre le 16e et le 19e siècle, c’est-à-dire au moment où la société atteignait un niveau de littératie particulièrement développé. C’est cette littératie avancée qui a permis l’essor fulgurant de la science qu’on a connu avec les Galilée, Newton et autres – essor qui, grâce aux applications technologiques et industrielles qu’il rendait possibles, a été vu comme un immense succès. Succès qui, à son tour, a présidé à l’établissement actuel de la science comme épistémologie première (voire comme seule épistémologie valable) ((Et bien que Whitehead protestait contre cette bifurcation, celle-ci apparaît désormais comme constitutive de la nature et du rapport entre la nature et l’esprit – une erreur que nous ne sommes pas près de corriger, malgré les travaux de nombreux penseurs, de Whitehead à Bateson à David Bohm. Mais cela n’est pas notre problème ici.)).
Or, du moment où il n’y a plus de continuité, plus de cohésion ontologique, entre la dimension physique et l’esprit, il y a aussi séparation entre le langage et l’être. Dans notre modernité tardive, la pensée étant liée au langage, associer l’art à l’être (la matière, la physis) revient à le découpler de la pensée. Ainsi, pour revenir à mon évaluateur anonyme, si je dis que l’art appartient à la dimension de l’expérience sensible, je suis réputée laisser entendre que l’art ne relève pas de la pensée. Aberration, évidemment, résultant de la séparation dont on parle.
Tout cela vous semblera peut-être très philosophique et sans rapport avec la recherche-création. Mais ce que je veux mettre en lumière (et vous verrez bientôt pourquoi), c’est qu’au moment où se produit cette bifurcation, l’art tombe d’un côté, et la science et la philosophie tombent de l’autre. Ainsi, dans le paysage épistémologique actuel, l’art – seul – fait contrepoids dans ce dualisme caractéristique de toute la vie intellectuelle occidentale. C’est pourquoi il questionne tant de philosophes, d’ailleurs.
Cette séparation remonte à bien plus loin que la bifurcation cartésienne (ou galiléenne ou newtonienne, c’est selon). Ces deux épistémologies dont je parle depuis le début, l’une « instaurative », l’autre « réductive » (je reprends les termes de Gilbert Durand), ont des racines très anciennes; certains auteurs en retracent les germes jusque dans l’invention de l’écriture alphabétique (Abram, 1996; Ong, 1982). Pour les questions qui nous occupent dans le présent article, remarquons qu’on les retrouve effectivement jusque dans le concept de mimèsis – ou d’imitation – que, tout à notre obsession pour la Grèce antique, nous avons installé au fondement de notre pensée sur l’art. Il est intéressant de noter que ce concept a eu deux périodes, si je puis dire : l’une archaïque, remontant à la tradition orale et l’autre datée du 5e siècle avant l’ère commune, c’est-à-dire la période des Socrate, Platon et Aristote – nos familiers.
In Delian hymns, […] imitation did not signify reproducing external reality but expressing the inner one. It had no application then in visual arts.
In the fifth century B.C. the term “imitation” moved from the terminology of cult into philosophy and started to mean reproducing the external world. (Encyclopedia of Ideas – je souligne)
Je veux bien que la Grèce classique soit le berceau de la philosophie, mais avouons, entre nous, qu’elle n’est pas une référence bien convaincante en matière d’art ou de compréhension de l’art, avec un Platon qui voulait exclure les poètes de la cité et un Aristote qui voyait ni plus ni moins les œuvres d’art comme des actions de re-présentation, autrement dit de deuxième instance. Ce n’est pas cette mimèsis-là qui nous intéresse, mais celle d’Homère, où ce qui est représenté dans l’art et la poésie n’est pas le réel visible, mais sa part invisible, intérieure, son contenu psychique, symbolique, sa signifiance. Aujourd’hui, on retrouve cette idée chez Souriau, lorsqu’il précise que « Debussy ne “représente” pas la mer : il l’instaure, plus pure et plus spirituelle », ajoutant ensuite : « l’admirable », en effet, « est que Debussy nous a présenté la signification esthétique de la réalité même » (1955 : 259 et 259 note 1). C’est aussi le sens de cette phrase bien connue de Paul Klee sur le fait que l’art ne reproduit pas le visible, il le rend visible (1985 : 34).
Du potentiel philosophique de la recherche-création
Cette idée de l’art comme expression d’une réalité intérieure – ou du versant intérieur de la réalité – prolonge l’épistémologie primordiale et originaire de l’humanité, c’est-à-dire notre capacité à invoquer des dimensions invisibles, à les rendre réelles et agissantes dans le monde physique. Et par « dimensions invisibles », je n’imagine pas d’abord des dimensions transcendantes, ultimes ou divines, mais bien plus simplement cette trame de compréhension et de signifiance qui est essentielle à la vie intime autant que collective. L’imaginaire humain est constamment à l’œuvre dans l’instauration de ces dimensions peut-être « invisibles », mais inhérentes à notre perception des choses. Car il faut voir que ce travail constructiviste de signification que notre imaginaire fait sans relâche est la condition incontournable de notre participation au monde : si nous ne voyons pas le sens d’une chose ou d’une situation, si nous ne pouvons la relier à rien d’autre, en effet, nous ne pouvons nous engager avec ou envers elle.
Donc voilà. J’ai cette idée que l’art d’aujourd’hui est un avatar relativement récent de cette épistémologie incantatoire (ou instaurative) qu’on retrouve dans les réalisations humaines au fil de l’histoire.
Bien sûr, la recherche-création n’est qu’une petite planète dans la grande galaxie de la connaissance. C’est marginal, la recherche-création. Mais si je peux prolonger un peu ma métaphore, cette petite planète tourne autour d’une immense étoile. L’art est immensément important dans la pensée occidentale, notamment parce qu’il opère selon cette épistémologie instaurative. De Hegel à Deleuze, et puis même Thomas d’Aquin (Eco, 1997), nombreux sont les philosophes qui ont vu dans l’art une manifestation paradigmatique de l’esprit humain. Il n’est donc pas du tout insensé de penser que sur notre « petite planète », nous avons le loisir d’expérimenter des approches et des méthodologies permettant d’aller au plus près de l’esprit instaurateur et des mécanismes de l’incantation. Alors ce qui m’intéresse dans la recherche-création, c’est lorsque j’y vois un début de méthodologie pour l’étude des composantes et des manifestations de cette opérativité de l’imaginaire. Il y a beaucoup d’études de l’art vu de l’extérieur, mais la recherche-création, elle, peut l’étudier de l’intérieur.
À suivre…
[heading style= »subheader »]Bibliographie[/heading]
ABRAM, David, The Spell of the Sensuous, New York, Random House, 1996.
DEWEY, John, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, Collection « Folio Essais », 2010.
DURAND, Gilbert, L’imagination symbolique, Paris, Presses universitaires de France, 1964.
ECO, Umberto, Art et beauté dans l’esthétique médiévale, Paris, Grasset & Fasquelle, 1997.
KLEE, Paul, Théorie de l’art moderne, Paris, Éditions Denoël, 1985.
MERLEAU-PONTY, Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.
ONG, Walter J., Orality and Literacy : the technologizing of the word, New York, Routledge, 1982.
SOURIAU, Étienne, L’ombre de Dieu, Paris, Presses universitaires de France, 1955.
TALEB, Mohammed, « 3 clés pour comprendre Alfred North Whitehead », Le Monde des religions, [en ligne]. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2011/50/alfred-north-whitehead-13-10-2011-1935_182.php (Page consultée le 20 juin 2016).
WHITEHEAD, Alfred North, Le concept de Nature, Paris, Librarie Philosophique J. Vrin, 2006. [Aussi disponible en version originale sur le Projet Gutenberg.]