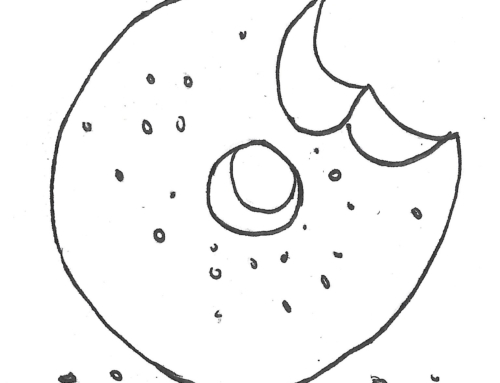Cependant, je n’ai pu m’empêcher de remarquer le petit calepin dans lequel l’homme inscrivait des notes dès que je prononçais un mot. David et moi dissertions sur les différences entre le narrateur faillible et le narrateur indigne de confiance ; il s’empressait de griffonner. David et moi débattions de la non-fiabilité du narrateur discordant ; il griffonnait. Je confiais au proprio une hypothèse farfelue selon laquelle les nombreux manuels d’histoire sont autant de récits de narrateurs non fiables ; il noircissait son calepin. Si bien qu’au comble de mon exaspération, je me suis plantée devant lui et me suis laissée emporter : « Vous avez fini, oui ? » Ce à quoi il a répondu d’une voix grave : « Non, nous ne faisons que commencer. »
Le nous me rappelait celui du mois de mai – catégorique et mystérieux – : nous reviendrons. Eh bien voilà, me disais-je, ils sont revenus, et qui plus est, ils se sont installés. Astucieux stratagème que celui du sans-abri. Ils ont appris des maîtres. Hermann Carlovitch, le narrateur de La méprise, ne fait pas mieux : il enrôle un vagabond, son double, nous assure-t-il, en tout point identique à lui-même, sauf que, manque de bol ‒ ou de lucidité ‒ le vagabond lui ressemble autant que Vladimir Poutine ressemble à Joseph Staline. Les hommes en noir avaient ici leur sans-abri, qui se faisait passer pour eux, qui préfigurait leur menace, qui préparait la fronde finale.
Oui, je le réalisais désormais : il aurait mieux valu que je ne laisse jamais entrer ce Toulousain dans mon appartement. En effet, plus je me sentais épiée, plus il me semblait clair que j’avais échoué le test la première fois. La solution m’apparaissait aujourd’hui évidente : les histoires abracadabrantes du voyageur auraient dû me pousser à le laisser moisir sur le balcon, comme Carlovitch échoue à me convaincre de son mensonge dès les premières lignes de son récit. Au lieu de ça, je lui ai fait confiance. Fatale erreur qui, jusque-là, m’a coûté mon intimité, mais quoi d’autre m’attendait encore ?
Rien de moins que deux personnages en noir sur le pas de ta porte, aurais-je pu répondre, si j’avais su que les choses allaient dégénérer à ce point. Octobre, en effet, avait amené deux autres spécimens avec mallette et veston ; différents des premiers, mais tout aussi suspects. Ils se sont avancés dans le hall, m’ont offert une poignée de main. Ils ont retiré leur foulard et déposé leur bagage. Puis, ils ont entrevu le Toulousain, qu’ils ont aussitôt salué. Tous les trois se sont mis à discuter vivement dans un langage que je savais à peine décoder. Il y avait un réel enthousiasme dans leurs échanges, malgré le sérieux de leurs habits et l’ombre qui dissimulait les traits de leurs visages. Bref, je ne cacherai pas que, devant cette folle mascarade, encore une fois, je me trouvais complètement démunie.
Je ne sais trop comment vous convaincre de l’étrangeté de la situation qui s’ensuivit. Du mois d’octobre lugubre que cela a entraîné. Comme trois hobos réunis sous un pont, les hommes tenaient un conciliabule dans mon salon ; ils maugréaient, tergiversaient, inaudibles, mais inquiétants ‒ tous les secrets sont inquiétants, suffit de lire les lettres de la Marquise dans Les liaisons dangereuses. Ils se nourrissaient de riz blanc dont ils faisaient des boules avec leurs doigts ; ils le mangeaient en me guettant, comme si ma présence menaçait leurs gamelles. Parfois, j’avais l’impression d’entendre, borborygme, rot ou flatulence, la déflagration d’un Paul Ricœur, et je fronçais les sourcils. Ce n’étaient pas là syllabes formées avec les cordes vocales, mais je savais capter ce que tout cela revêtait d’insidieux. Puis vint la suite.
Ils me regardaient fixement depuis leurs fauteuils, mes fauteuils, lesquels avaient jadis été beiges, mais ne l’étaient plus, parce que les hommes avaient formé des cernes ‒ un peu de décoloration, beaucoup de renflements, ajustés à la courbe de leurs dos. Et tous les matins, m’habiller au sortir du lit, me maquiller avant le premier café pour affronter ces regards, me paraissait une lourde besogne – ces regards qui, un beau jour, m’ont littéralement embrochée. J’ai pris conscience soudain – mais où était passé David ? – que j’étais une femme sans défense livrée à trois hommes qui tenaient salon ‒ ou, du moins, l’assiégeaient, encore que j’ignore si j’écris ceci en référence à mes fauteuils souillés. Dans tous les cas, j’avais peur, je craignais pour la chasteté du savoir, mais c’était dans l’air du temps. Vous comprendrez que j’ai soupiré d’aise quand ils m’ont demandé des gaufres.
Et l’itinérant a complété le verbiage de ses deux coreligionnaires, en spécifiant : « Après, on commence pour de vrai. »
« Pardon ? » ai-je fait, ahurie.
Le plus petit des hommes en noir s’est étiré et j’ai cru entendre dans le gargouillement de son ventre, Boooooth. J’ai su alors que quelque chose d’implicite se préparait vraiment.